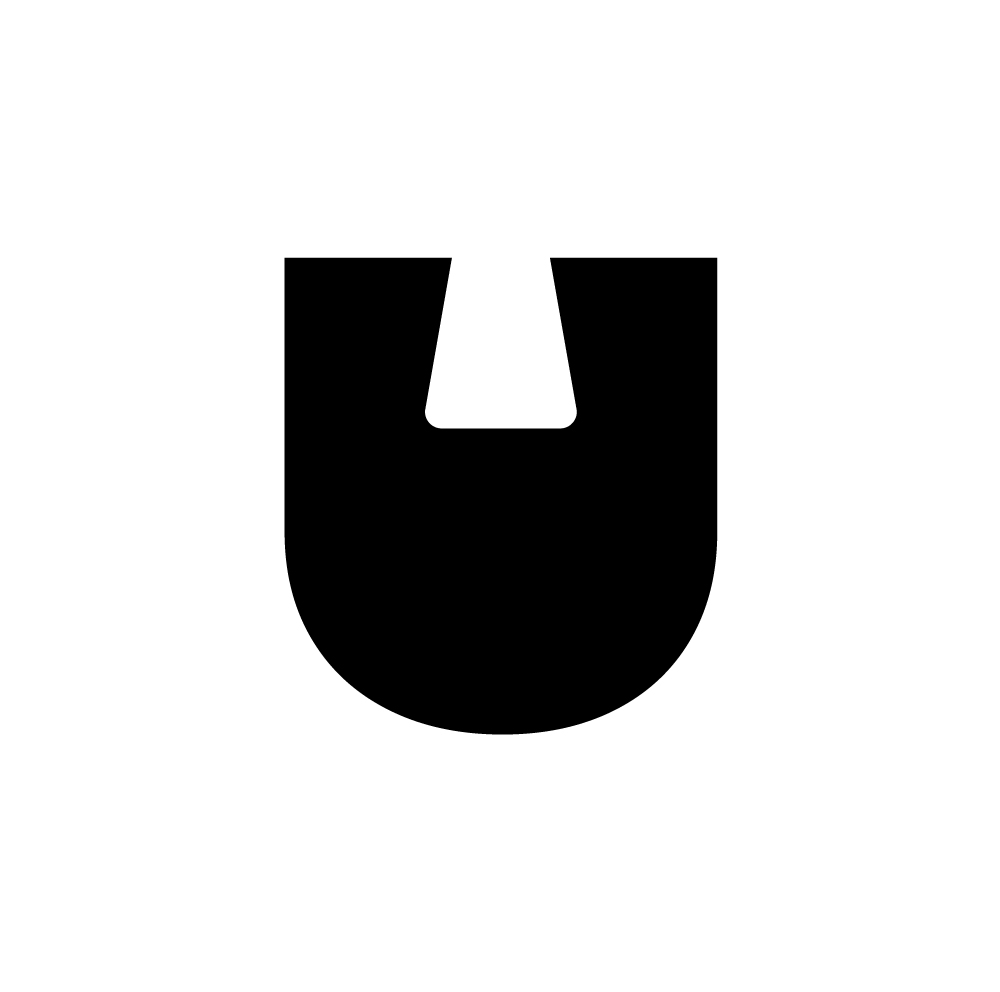Certaines décisions de justice marquent plus que d’autres.
Elles forment un « socle jurisprudentiel » plus ou moins mouvant au fil du temps et font la richesse du Droit et le bonheur… des juristes. Le droit des sociétés n’échappe pas à ce principe.
La Cour de cassation est, pour le droit privé, à l’origine de la plupart de ces décisions qui marquent, bien qu’elle ne soit pas exclusive en la matière.
Une partie de ces décisions, les plus mises en avant, sont parfois identifiées par le nom d’une partie en cause. Il en est ainsi de l’arrêt « Vilgrain » de 1996, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui avait reconnu l’existence d’une réticence dolosive de la part d’un dirigeant ayant manqué à son devoir de loyauté à l’égard des associés d’une société, à l’occasion d’une cession de titres de ladite entreprise.
Le principe d’un devoir de loyauté du dirigeant était définitivement posé. Les mandataires sociaux étaient ainsi invités à agir bien évidemment conformément à l’intérêt social mais également dans le respect de l’égalité de traitement des associés. Le dirigeant-associé n’est pas un associé comme un autre, il ne peut profiter à titre personnel d’informations dont il a connaissance du fait de son mandat social.
La cession de titres d’une société est une source importante de contentieux et au fil du temps la Cour de cassation fut amenée à étoffer sa jurisprudence au regard de l’obligation de loyauté d’un dirigeant également associé à l’égard des autres associés, dès qu’il était notamment question de valorisation des titres formant le capital social de la société concernée.
Par un arrêt « Baldus » de mai 2000, la Cour de cassation vînt par exemple préciser que cette obligation de loyauté ne pesait pas de manière générale sur tous les acquéreurs ou vendeurs et qu’une partie non dirigeante n’était pas tenue à une obligation générale d’information à l’égard de son cocontractant.
Les juges des tribunaux de commerce, comme les magistrats professionnels, sont tenus d’appliquer les règles de droit. Mais le non initié n’a pas toujours connaissance du fait que les juges ne sont pas tenus d’appliquer stricto sensu la jurisprudence établie par la Cour de cassation. Tribunaux de première instance et Cours d’appel jugent en droit les cas d’espèces qui leur sont soumis, en prenant parfois le risque d’être censurés par la plus haute juridiction.
Par un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mars dernier, les juges consulaires ont considéré, au regard des faits de l’espèce, que même s’il était établi qu’à l’occasion de la valorisation d’une société, son dirigeant avait délibérément fait en sorte de minimiser, dans son intérêt, la valeur des titres de la société, en cachant l’impact de futurs contrats fructueux sur la valeur de l’entreprise, il s’avérait que les associés se plaignant de l’attitude du dirigeant, en l’espèce des fonds d’investissements dont la compétence ne pouvait qu’être reconnue, avait commis une erreur inexcusable en ne tenant pas compte d’autres informations qu’ils ne pouvaient ignorer.
Le jugement concerné ayant donné lieu cependant à la condamnation du dirigeant indélicat sur un autre fondement, il n’est pas certain que cette décision soit frappée d’appel, de telle sorte que l’on ne saura peut-être pas si la Cour d’appel puis la Cour de cassation auraient suivi les juges de première instance dans leur analyse.
C’est ce type de décision de première instance qui donne un jour naissance à un arrêt de jurisprudence honoré ou critiqué, pendant des années, par la doctrine et les praticiens et fait la joie… ou le désespoir des étudiants en droit.
Ces décisions rendues par nos tribunaux participent à la richesse de notre Droit.